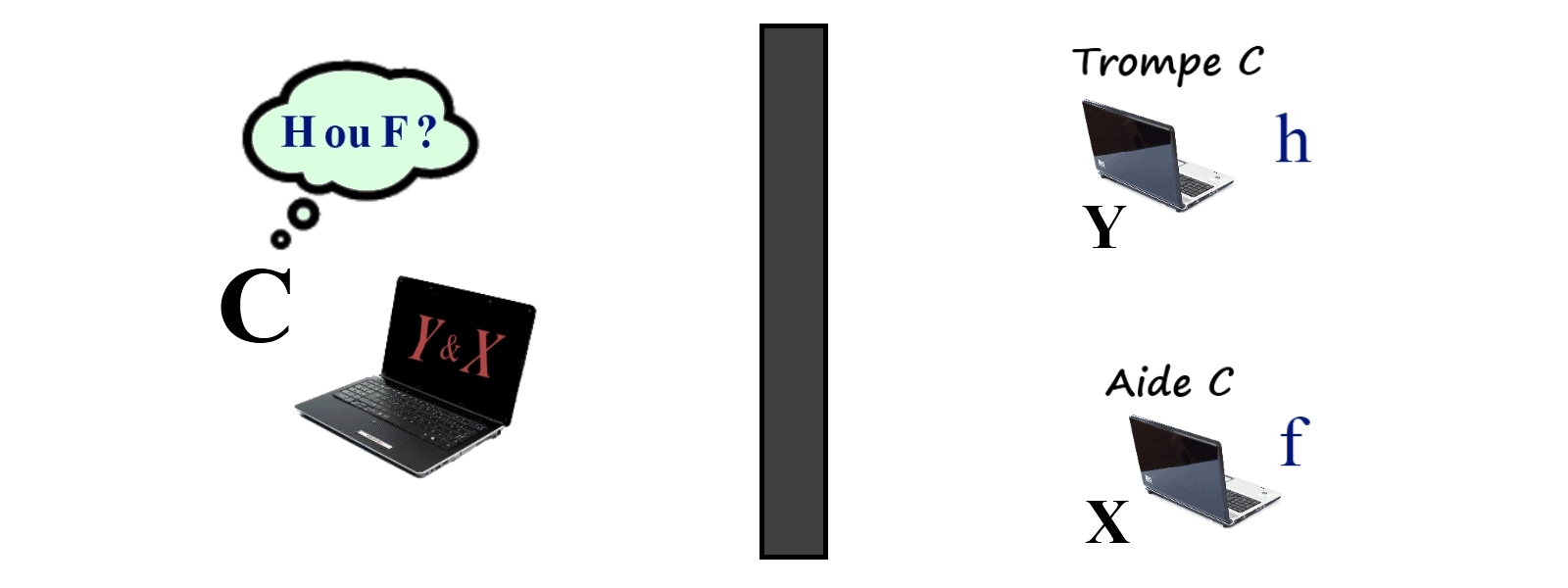
Alan Turing 1950 - Les Ordinateurs et l'Intelligence
| Section 1 Le jeu de l'imitation |
Section 2 |
Cybernétique et Psychanalyse
- - - - - - - Une
lecture par DWT pour une étude
des Temps Présents - - - - - -
-
De la psychologie homme/femme à l'informatique de Turing
La première section de "Les Ordinateurs et
l'Intelligence" écrit par de Alan Turing en 1950 a entraîné un
"remarquable" enthousiasme de la part des psychanalystes et particulièrement des
lacaniens dont le maître en 1960 soulignait la clé donnée par Alan E.Poe dans "La Lettre Volée".
Il plaçait l'imitation
comme la solution-clé d'un dénommé jeu pair-impair. Cette solution, avait
conclu (pratique) Lacan, aboutissait à la conclusion (idéale) que
les ordinateurs
réaliseraient des (psych)analyses en détectant plus efficacement que l'être
humain lui-même le refoulé de son Inconscient. Or Turing intitule
sa première
section "Le jeu de l'imitation"
|
Notre travail aujourd'hui est autant de comprendre comment la
vie de Turing aboutit aussi lamentable que l'enseignement de Lacan aussi
inhibé.
Pour commencer à savoir si les machines peuvent penser, Lacan sera parti
d'un manège à trois termes s'autoreconduisant (ce qu'il appellera triade
reproduite en successions dites brunniennes). Turing au préalable
avait également posé un jeu de trois : A, B et C, que nous
appellerons aujourd'hui : Y, X et C - c'est à dire un homme H, une femme
F et C l'interrogateur. Le problème que l'interrogateur doit résoudre
est de savoir si Y est bien homme ou femme et inversement.
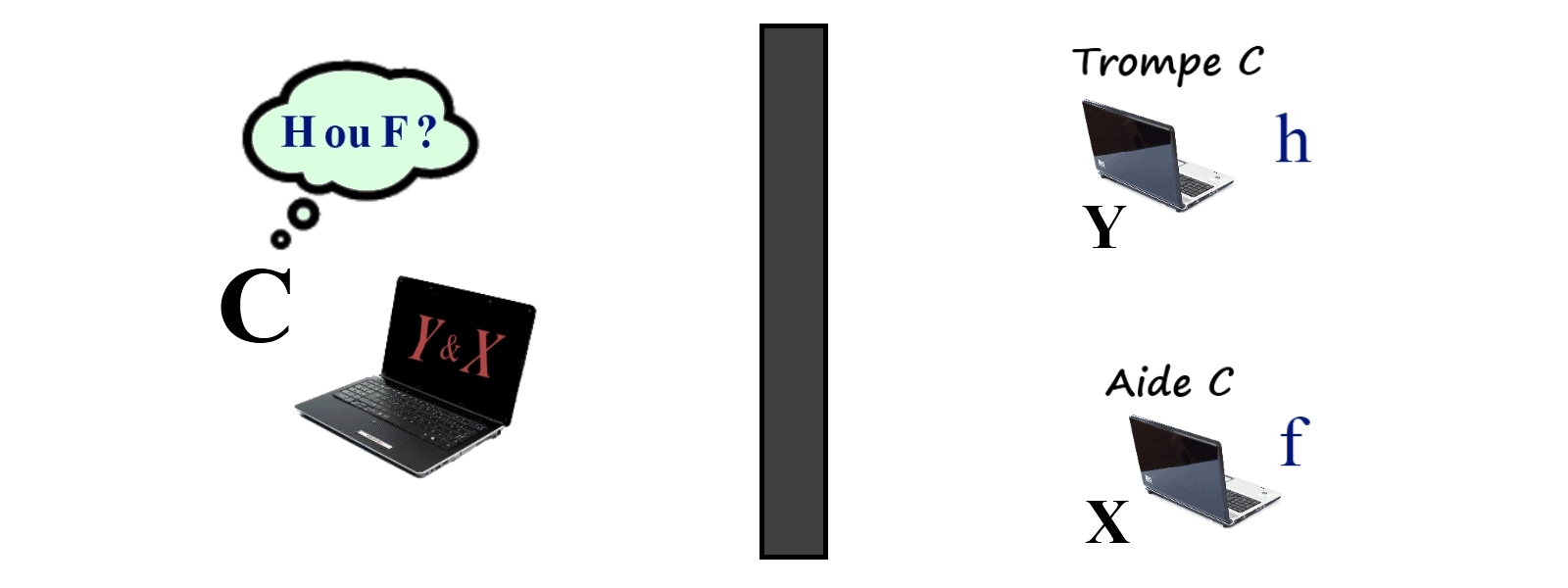
A ce rôle de C s'ajoute les rôles respectifs de Y et X
à savoir : pour l'homme, d'induire C en erreur et pour la femme au
contraire, d'aider l'interrogateur. Par exemple, à la question de
C « Quelle est la longueur de vos cheveux? » Y répondra « Mes
cheveux sont coupés à la garçonne.» Ainsi le problème de
l'interrogateur peut-il être posé, d'autant que de l'autre côté, X
aura beau dire « Je suis la femme, ne l'écoutez pas! » Turing
note que l'homme peut dire la même chose de sorte que C ne peut pas s'y
fier.
Telle est donc la première section de l'article et
on pourrait trouver son 'jeu' plutôt brouillon s'il n'indiquait
pas la beaucoup plus rigoureuse énigme connue des deux sphinges, l'une
mentant toujours et l'autre disant toujours la vérité, auxquelles d'une
seule question à l'une ou l'autre Oedipe doit trouver le bon chemin qu'il
prendra (La Sainte Éthique permet grâce à la solution de
trouver le chemin de la psychologie collective). Toujours en
défaveur de la description de Turing, elle permet mal de distingue
pourquoi on l'appelle "jeu de l'imitation". Ce n'est
qu'à la fin de la section que Turing rehausse et relance sa
démonstration. Il indique que cette mise en scène mal ficelée n'a été
composée que pour recevoir son terme absolument effectif : que se
passe-t-il si à la place de l'homme on met une machine?
|
Ce que Turing a dénommé "Jeu de l'imitation" a pour but
de répondre à la question : « Les machines peuvent-elles penser?»
Comme il estime que les significations tant du mot 'machine' que de
celui de 'penser' sont trop incertaines, il entreprend de composer
une mise en scène qui produira la réponse - du moins l'espère-t-il
comme bon mathématicien qui compose une formule 'abstraite' pour
résoudre un problème d'une autre nature, 'concrète'. Ainsi une seconde section est-elle ouverte qui va, elle, placer l'imitation en système et, cette fois, décisivement dépasser le jeu de la vérité et du mensonge en même temps que justifier du titre que Turing a donné à son jeu. |
Annexes
a)
|
Vers Réflexions / Littérature Grise DWT |
b)
|
Source |
|
texte original de Turing section 1 1. Le jeu de l'imitation Je propose de considérer la question: «Les machines peuvent-elles penser? » Il faudrait commencer par définir le sens des termes « machine» et « penser ». Les définitions peuvent être conçues de manière à refléter, autant que possible, l'utilisation normale des mots, mais cette attitude est dangereuse. Si on doit trouver la signification des mots « machine» et « penser » en examinant comment ils sont communément utilisés, il est difficile d'échapper à la conclusion que la signification de la question «Les machines peuvent-elles penser?» et la réponse à cette question doivent être recherchées dans une étude statistique telle que le sondage d'opinion. Mais cela est absurde. Au lieu de m'essayer à une telle définition, je remplacerai la question par une autre, qui lui est étroitement liée et qui est exprimée en des termes relativement non ambigus. Le problème reformulé peut être décrit dans les termes
d'un
jeu que nous appellerons le «jeu de l'imitation ». Il se
joue à
trois: un homme (A), une femme (B) et un interrogateur (C)
qui peut être de l'un ou l'autre sexe. L'interrogateur se
trouve
dans une pièce à part, séparé des deux autres. L'objet
du jeu,
pour l'interrogateur, est de déterminer lequel des deux
est
l'homme et lequel est la femme. Il les connaît sous les appellations X et Y et, à la fin du jeu, il doit déduire soit
que « X est
A et Y est B », soit que «X est B et Y est A ».
L'interrogateur
peut poser des questions à A et B de la manière suivante: Nous posons maintenant la question: «Qu'arrive-t-il si une machine prend la place de A dans le jeu? L'interrogateur se trompera-t-il aussi souvent que lorsque le jeu se déroule entre un homme et une femme? » Ces questions remplacent la question originale: «Les machines peuvent-elles penser?» --- section suivante |